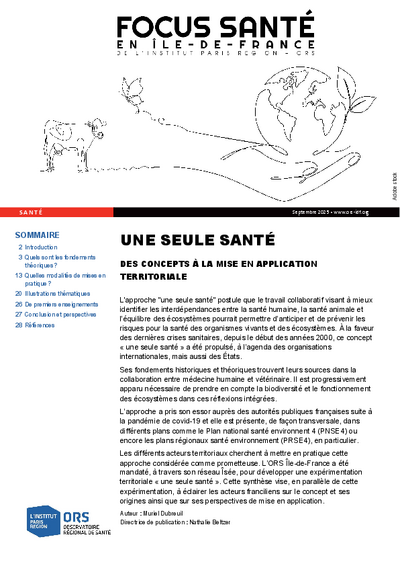Une seule santé : des concepts à la mise en application territoriale
À la faveur des dernières crises sanitaires dont la pandémie de covid-19, ce concept a été introduit et adopté progressivement par les institutions internationales spécialisées et par les États. En France, il apparaît, de façon transversale dans différents plans comme le quatrième plan national santé environnent (PNSE4) ou encore en Île-de-France le quatrième plan régional santé environnement (PRSE4).
Cette approche s’appuie sur des collaborations entre médecine vétérinaire et médecine humaine et la connaissance des écosystèmes. Elle cherche à dépasser les limites traditionnelles entre les disciplines qui tendent à fragmenter les savoirs et à travailler de façon plus systémique en faisant collaborer médecins, vétérinaires, écologues, agronomes, responsables locaux afin de mieux identifier et anticiper des problématiques à l’interface des santés humaine et animale et des écosystèmes. L’approche sort d’une vision purement anthropocentrée de la santé.
L’ORS Île-de-France a été mandaté, à travers son réseau Îsée, pour développer une expérimentation territoriale « une seule santé ». Dans le cadre de cette mise en œuvre, un état des lieux sur le concept et ses origines ainsi que sur les perspectives de mise en application a été réalisé et est présenté dans cette synthèse. Sont ainsi identifiés à travers la littérature scientifique les atouts, mais aussi les leviers et contraintes identifiés pour éclairer les acteurs franciliens.
Parmi les éléments essentiels :
- « Une seule santé » s’est historiquement intéressé aux zoonoses (transmissions infectieuses entre animaux et humains).
- Les liens entre les récentes émergences infectieuses et les dégradations de l’environnement ayant des causes anthropiques sont de mieux en mieux établis. Les modalités de travail « une seule santé » visent à mieux caractériser ces liens et à prévenir précocement les risques.
- Cette approche intégrée de la santé entraine des conséquences opérationnelles importantes : notamment la transdisciplinarité, nécessaire pour faire émerger de nouvelles connaissances, et qui modifie les façons d’appréhender les risques et les déterminants de la santé.
- Différents critères de réussite de modalités de collaborations « une seule santé » sont identifiés dans la littérature, comme s’appuyer sur les collaborations existantes, identifier les soutiens, sensibiliser et former, développer un langage commun, etc.
- La lutte contre l’antibiorésistance représente un exemple emblématique de l’intérêt de « une seule santé ». En effet, l’utilisation non rationnelle d’antibiotiques dans divers secteurs (santé humaine, élevage, agriculture) participe au développement des résistances.
- De nombreuses autres thématiques peuvent trouver des résolutions plus efficaces par des collaborations « une seule santé » : ce sont par exemple les problématiques en lien avec l’alimentation et les sols, l’eau, l’émergence de vecteurs de maladies transmissibles, etc.
Cette étude est reliée aux catégories suivantes :
Santé |
Politiques publiques et santé |
Environnement et santé